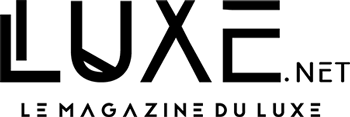Dans l’univers feutré de la joaillerie, où chaque geste se transmet autant qu’il s’invente, les décisions stratégiques se prennent souvent loin du bruit. En annonçant un accord en vue d’acquérir Raselli Franco Group, Kering affirme avec élégance une conviction profonde : l’avenir du luxe se construit dans la maîtrise des savoir-faire, au plus près de la matière et du temps long.
Luxe : Un horizon à 2 700 milliards d’euros pour 2035, malgré une décennie de challenges
Au cœur d’un monde chahuté, où l’incertitude semble devenir la seule norme stable, le luxe poursuit sa trajectoire singulière : résilient, mouvant, et plus vivant que jamais. Le nouveau rapport Bain & Company, réalisé avec la fondation Altagamma, en offre une radiographie précieuse. Si 2025 s’annonce comme une année d’équilibre — 1 440 milliards d’euros dépensés à l’échelle mondiale, un niveau comparable à celui de 2024 — c’est dans les mouvements souterrains que se lit la véritable transformation du secteur. Plus qu’un marché, le luxe devient un langage. Et ce langage, désormais, glisse doucement vers l’expérience.

L’expérience avant l’objet : la mutation silencieuse du désir
L’époque change, et les envies avec elle. Le luxe se déplace, migre du tangible vers l’intangible, du sac possédé au voyage vécu, du bijou porté au souvenir gravé. Les consommateurs privilégient désormais les expériences haut de gamme — voyages hors du temps, retraites de bien-être, découvertes gastronomiques — au détriment de l’accumulation d’objets.
Ce glissement redessine les contours du secteur : les biens personnels de luxe devraient atteindre 358 milliards d’euros en 2025, un rythme ralenti, comme si l’objet n’était plus tout à fait suffisant pour combler les nouvelles aspirations. Le désir s’affine, se spiritualise, se déploie ailleurs.
Dans cette recomposition, une polarisation s’accentue. Les ultra-riches continuent d’alimenter les ventes les plus exclusives, fidèles aux pièces rares et aux savoir-faire d’exception. À l’inverse, les consommateurs aspirationnels ralentissent, infléchis par un climat économique moins clément et un rapport plus discret au prestige. Les segments plus accessibles gagnent ainsi en importance, tout comme les canaux jouant sur la valeur — outlets, resale, vintage — devenus des terrains d’expression du luxe contemporain.

Un luxe géographique en mouvement
À l’échelle mondiale, la carte du luxe se redessine. La Chine, longtemps locomotive, marque un temps d’arrêt. Le Japon et l’Europe s’essoufflent à leur tour, freinés par la force de l’euro, la baisse du tourisme et une atmosphère géopolitique incertaine.
Mais d’autres régions se lèvent, affirmant leur propre tempo. Les États-Unis se stabilisent, l’Amérique latine affirme un dynamisme nouveau, et surtout, le Moyen-Orient rayonne. Dubaï, Abu Dhabi et Doha deviennent des scènes mondiales du haut de gamme, où s’entremêlent clients locaux exigeants, voyageurs fortunés et ambition culturelle. Parallèlement, une constellation émergente — Asie du Sud-Est, Inde, Afrique — monte en puissance. Ensemble, ces marchés représentent déjà 45 milliards d’euros, soit autant que la Chine continentale : une donnée symbolique, presque prophétique.

2035 : l’aube d’un luxe réinventé
Pourtant, au-delà des secousses, l’avenir du luxe demeure lumineux. Bain & Company anticipe une croissance annuelle de 4 à 6 % pour les biens personnels jusqu’à 2035, qui pourraient ainsi atteindre 525 à 625 milliards d’euros. Plus largement, le marché global du luxe pourrait culminer entre 2 200 et 2 700 milliards d’euros.
Derrière ces chiffres, une vérité simple : le luxe change de nature, mais ne faiblit pas. Il s’adapte, se réinvente, s’allège parfois de son apparat pour mieux renouer avec l’essentiel — l’émotion, la rareté, l’expérience intime. Le luxe de demain sera peut-être moins ostentatoire, mais plus riche de sens. Moins une vitrine, plus un voyage. Une façon de redonner de la profondeur au temps, et de l’âme à ce qui nous entoure. Dans une décennie de turbulences, c’est peut-être là que se cache la vraie force du luxe : dans cette capacité à offrir, encore et toujours, un refuge, un rêve, une parenthèse qui résiste à tout.