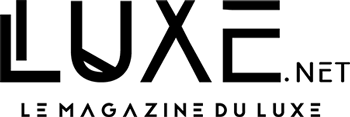Il y a des gestes qui relèvent du mécénat, et d’autres qui dessinent une stratégie d’influence. Avec le lancement effectif de son Prada Film Fund, la Fondazione Prada choisit la seconde voie : celle d’un soft power cultivé, structuré, assumé.
Rencontre avec DARMO Art en l’honneur de l’exposition Wonder par Juliette Barthe : L’art comme expérience, la collection comme récit
Ni galerie au sens strict, ni institution figée : DARMO Art avance à contre-rythme, avec une idée simple et radicale : redonner au regard son pouvoir. À Paris, dans un appartement qu’on rejoint sur rendez-vous, et à travers un réseau de lieux partenaires en Europe, DARMO construit une scène où l’art émergent rayonne, où le patrimoine dialogue, et où l’innovation n’efface jamais l’émotion. Rencontre avec Alexis D’Armau de Bernède, Léopold Mazieres et Marius Jacob-Gismondi, collectionneurs devenus passeurs.
Il y a des espaces qui ne se traversent pas : ils se vivent. Chez DARMO, rien n’est sur rue, et cela change tout. On écrit, on réserve, on vient. Le temps se dilate. Les volumes, hauts, laissent aux œuvres leur respiration. Et l’on comprend vite que l’essentiel n’est pas seulement ce qui se montre, mais la manière dont on le montre : comme une invitation à ralentir, à regarder, et vraiment, à laisser l’art être : celui qui touche, interroge, et parfois transforme.

DARMO Art, qui êtes-vous, et que défendez-vous ?
DARMO, c’est deux choses. D’abord, un programme de soutien aux artistes émergents : on les aide à rayonner à travers des projets parfois “fous”, auxquels ils n’auraient pas forcément pensé et on met en place toute la machine autour pour les rendre possibles. Ensuite, nous gérons et accompagnons des collections : achat, vente, prêts aux musées, mais surtout un travail essentiel d’archivage. Retracer l’historique des pièces, enrichir leur récit, alimenter ce que l’on appelle le “CV de l’œuvre”, car une œuvre n’existe pas seulement par sa beauté, elle existe aussi par sa trajectoire.

DARMO est présent à Paris… et ailleurs. Comment s’écrit cette géographie ?
À Paris, on monte entre cinq et sept expositions par an, plus deux ou trois en dehors. Et nous avons des lieux partenaires où nous revenons régulièrement : Antibes l’été, Bucarest environ tous les dix-huit mois, un lieu au nord de Berlin, un autre près de Venise. On n’est pas partout tout le temps, mais on revient, comme on revient à un chapitre qu’on veut continuer d’écrire.

Votre positionnement est singulier : ni strictement commercial, ni institutionnel. Qu’est-ce que cela vous permet ?
Cela nous permet de placer le marchand presque en second plan. L’art contemporain, chez nous, est souvent perçu comme un geste proche du mécénat : se rassembler pour soutenir des projets majeurs. On finance la production, on avance des frais, on accompagne aussi des projets hors de nos murs : institutions, résidences… On ressemble parfois à des agents, mais on ne se définit pas ainsi : ce sont des relations au long cours, presque des amitiés.
Et nous travaillons avec un à trois nouveaux artistes par an, souvent rencontrés via le Darmo Art Prize que nous organisons tous les deux ans : première édition en 2024, prochaine en octobre 2026, avec un jury composé de directeurs de musée, commissaires, critiques, philanthropes. Le prix est une porte d’entrée : ensuite, certains artistes nous rejoignent durablement, d’autres ponctuellement mais toujours avec l’idée de diffusion et d’accompagnement.


Votre ADN semble tenir en trois mots : art, patrimoine, innovation. Comment cela se traduit-il dans vos choix curatoriaux ?
Cela vient assez naturellement parce que nous sommes tous collectionneurs, et amoureux de l’histoire de l’art. Un collectionneur ne vit pas qu’avec l’émergence : il a besoin de racines. C’est pourquoi, en parallèle de chaque exposition d’art contemporain, nous présentons aussi une sélection d’œuvres majeures du XXe siècle, souvent en dialogue avec l’artiste exposé ou avec l’actualité culturelle à Paris.
On ne communique pas forcément dessus en ligne : c’est une expérience vécue sur place. L’idée, c’est de montrer où se place l’artiste dans l’histoire de l’art, sur quelle branche il prolonge l’arbre. Un artiste n’est pas obligé de révolutionner : parfois, il suffit de chuchoter une proposition nouvelle, l’essentiel est de savoir ce qu’on ajoute.

Vous insistez sur l’expérience “physique”. Pourquoi est-ce devenu si crucial ?
Parce qu’aujourd’hui, on reçoit des listes d’œuvres, on suit des artistes sur Instagram : c’est formidable pour diffuser, mais l’art ne peut pas être réduit à l’écran. Nous voulons que les gens viennent, prennent le temps, aient un échange, qu’ils achètent une œuvre à moins de mille euros, du mobilier, une pièce à plusieurs centaines de milliers, ou rien du tout. Le fait d’être en appartement, sur rendez-vous, permet cette intimité : on passe du temps avec chacun. Il ne s’agit pas “d’éduquer” au sens vertical, mais d’ouvrir des portes, de donner un œil, un contexte, une histoire.

Comment abordez-vous une exposition : concept, matière, geste… ou rencontre ?
D’abord la rencontre, souvent. Et ensuite, une conversation. On monte les expositions main dans la main avec les artistes : on leur demande littéralement leur “liste au Père Noël”. S’ils pouvaient tout avoir, qu’est-ce qu’ils aimeraient voir dialoguer avec leur travail ? Et nous partons à la recherche des œuvres.
Parfois, l’artiste veut que tout commence et finisse dans l’espace. Parfois il est très ouvert à un contrepoint. En novembre, par exemple, nous exposions Radu Baies, peintre figuratif, pendant Paris Photo : il trouvait pertinent d’avoir une exposition de photographies en parallèle pour attirer un autre public. Ce lieu doit pouvoir vivre de multiples manières.

WONDER — Juliette Barthe : Quand l’image refuse d’être captive
Juliette Barthe est en cinquième année aux Beaux-Arts de Paris. Elle était finaliste du Darmo Art Prize en 2024. Son point de départ est limpide : aujourd’hui, on “consomme” l’art au sens de découverte, via des écrans, photos WhatsApp, vidéos, réseaux, sites, livres. On croit voir, mais on ne voit jamais vraiment. Alors elle a construit une réponse presque paradoxale : “Mes œuvres seront merveilleuses sur écran. Mais ce ne sera jamais pareil que devant.”


Qu’est-ce qui fait la singularité matérielle de ses œuvres ?
Elle travaille sur une toile rétro-réfléchissante : un support qui renvoie la lumière et change selon la position du regardeur. Les images viennent d’empreintes de doigts et de main : compositions initiales en lithographie ou via une imprimante Riso (la risographie, technique japonaise des années 80), puis agrandissements, rétrécissements, et enfin sérigraphie sur la toile. La série fonctionne comme une suite d’itérations d’un même protocole, avec une filiation assumée vers le minimalisme : monochromes gris, encre grise, toile grise. Mais dès qu’on bouge, tout bascule.

Comment la scénographie rend-elle cette instabilité immersive ?
Il y a autant de façons de vivre l’œuvre qu’il y a de places autour d’elle et de conditions de lumière. Parfois, on ne voit qu’un monochrome sans texture. Puis on se déplace : les empreintes surgissent. On éteint : reflets différents. La nuit : autre lecture. Une lumière directe, type flash : l’œuvre devient presque blanche, parfois dorée, parfois bleutée.
L’œuvre n’est pas une image fixe : c’est une expérience. Et le visiteur devient une partie du protocole, ce sont nos yeux qui rendent l’œuvre vivante.

Instagram et l’art : Nouvelles opportunités ?
Instagram permet une circulation incroyable : on découvre une quantité d’œuvres immense. Et cela change même la lecture des musées : autrefois, les musées publics représentaient l’identité d’un pays, puis les œuvres circulaient entre institutions. Aujourd’hui, les images voyagent partout, vues par des regards issus d’histoires et de cultures différentes : l’œuvre se lit autrement, à l’échelle d’une histoire plus globale de l’art. Oui, les réseaux sociaux peuvent pousser à la consommation, au manque de contexte. Mais la contrainte n’est pas forcément négative : c’est un cadre qui s’élargit. Il faut savoir jouer avec. Juliette est, pour nous, une artiste “post-digitale” : elle dépasse le digital sans le nier. On peut vivre son œuvre sur écran mais le cœur est ailleurs : dans la présence humaine.

Vous parlez d’un nouveau terrain d’entente entre technologie et matière…
Oui. On voit des artistes qui réconcilient ceux qui aiment la technologie et ceux qui ne jurent que par l’objet. Je pense à Aurèce Vettier : il écrit des algorithmes très personnels pour créer des objets physiques. Les publics se retrouvent autour de l’œuvre. Pendant longtemps, le “new media art” parlait à un écosystème précis, presque fermé. Aujourd’hui, les frontières bougent : de nouveaux mouvements se créent, et c’est passionnant de se dire que ce que nous vivons maintenant sera peut-être étudié dans trente ans.


Comment avez-vous pensé l’exposition historique en dialogue avec WONDER ?
Nous avons construit un corpus autour du minimalisme mais pas uniquement. Il y a aussi du mobilier : Jean Prouvé, Pierre Chareau, Jean-Michel Frank. Dans une maison de collectionneur, ces pièces dialoguent naturellement avec une esthétique minimaliste. Nous montrons des œuvres majeures : Sol LeWitt, avec un dessin de 1972 ; une chaise de Donald Judd ; des pièces de Keith Sonnier, dont une sculpture de 1966 issue de ses premières explorations. Sonnier a été remis en lumière en 1989 à New York par Léo Castelli et Barbara Gladstone : la pièce exposée provient de cette histoire-là, et elle est restée dans la même collection depuis.
Nous présentons aussi Niele Toroni et ses empreintes régulières, des journaux et toiles des années 90 ; du mobilier de Robert Wilson ; la couleur de Günther Förg ; et une artiste que nous aimons particulièrement : Marcia Hafif, grande figure du monochrome, longtemps sous-regardée, mais aujourd’hui reconnue — notamment avec une exposition au MAMCO (Genève) en 2019. Ce sont des œuvres qui n’apparaissent pas en scroll : il faut venir pour les découvrir.


DARMO demain : une plateforme, un laboratoire, une communauté
Nous continuerons les expositions personnelles, mais nous voulons aussi travailler davantage sur des expositions qui rassemblent des artistes autour d’un thème, d’un médium, d’une histoire — parce qu’aujourd’hui, on parle moins de mouvements artistiques : les pratiques sont éclatées géographiquement, et les liens restent invisibles.
Nous voulons aussi mettre en lumière des artistes des nouveaux médias, loin de la spéculation, dans une recherche philosophique et technologique. Et rappeler l’histoire longue : l’art génératif commence fin 50, années 60. Vera Molnar, par exemple, utilisait des ordinateurs gigantesques pour déformer des carrés : on la prenait pour une folle, aujourd’hui elle est majeure et reconnue. Les nouvelles générations ne veulent pas répéter : elles veulent construire.

Vous parlez souvent de “communauté”. Elle a quel visage ?
Il y a ceux qu’on voit tout le temps, entre Basel, Paris Photo, et le vernissage de Juliette Barthe, trois événements en un mois et demi : ils viennent, ils sont heureux, ils ont hâte d’être surpris.
Et puis il y a ceux qu’on ne rencontre jamais physiquement : des échanges réguliers depuis des années, des conversations qui deviennent proches. Cela peut sembler étrange, mais c’est réel et cela permet aussi de faire circuler l’art au-delà des frontières.
Ce week-end, on fait une hot-dog party avec Brieuc Bouwens (Beaux-Arts de Paris). Il va créer une édition limitée de cent impressions risographiques… qui seront des enveloppes à hot-dog. Il reconstitue un chariot new-yorkais, on distribue des hot-dogs, et les traces de ketchup ou de moutarde font partie de l’œuvre.
C’est une performance, une question posée : qu’est-ce que l’art ? quelle est l’interaction avec le spectateur ? Et surtout : figer un moment collectif dans un objet qu’on jetterait habituellement mais qui, ici, devient un marqueur de présence.

Et enfin, votre définition du luxe ?
Le luxe, c’est de pouvoir faire ce qui nous rend heureux. Cela peut être s’offrir un objet qu’on aime, un sac, une montre, un bijou, une œuvre d’art. Mais aussi, dans la vie quotidienne, faire quelque chose qui nous plaît : une balade le long de la mer, la nature, un paysage. Le luxe n’a pas la même forme pour tout le monde.
Et la liberté d’entreprendre est un luxe. Nous avons eu la chance d’être soutenus très jeunes. Nos premières expositions, on les a financées avec nos économies d’étudiants. C’était peu et énorme à la fois. C’était notre luxe : faire ce qu’on aime, avec nos moyens, sans demander à personne.